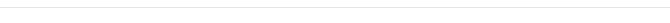Espaces protégés
L'augmentation des activités de pleine nature met en péril l'équilibre écologique de la montagne.
Afin de promouvoir une pratique autonome et responsable de la montagne, la FFCAM a publié plusieurs recommandations pour la pratique de nos activités respectueuses du milieu naturel.
Dès la fin du 19e siècle certains membres du Club Alpin Français ont commencé à se préoccuper de la sauvegarde du patrimoine naturel afin d'en faire bénéficier le plus grand nombre et de lutter contre les prémisses de l'exode rural en montagne en développant le tourisme.
En 1910, le club alpin est l'un des fondateurs de l'association pour les parcs nationaux, en vue de la création de tels parcs en France.
Des scientifiques et des écrivains se sont élevés, tout au long du 20e siècle, contre des projets d'aménagements jugés agressifs pour le milieu, notamment les téléphériques pour atteindre les sommets majeurs. La revue du CAF, « La Montagne » puis « La Montagne et Alpinisme », témoigne des efforts menés par ces personnalités qui au travers de nombreux articles n'ont pas hésité à pousser des cris d'alarme.
Les premières actions de notre club s'orientent vers des classements de sites menacés par des aménagements touristiques comme le classement de La Meije en 1934 qu'un projet de téléphérique au sommet risquait de défigurer, ou celui du massif du Mont Blanc en 1951.
Le Club Alpin Français fut parmi les promoteurs les plus actifs de la création du Parc National de la Vanoise puis de celui des Ecrins.
Depuis la création des parcs nationaux, des personnalités proposées par la FFCAM siègent au sein de leurs conseils d'administration. Ils y défendent nos pratiques sportives tout en prêtant une oreille attentive aux problèmes environnementaux. Ils ont un rôle de conciliateurs entre la liberté d'accès et la nécessité de protéger les espaces naturels contre des intrusions intempestives qui dérangent la faune et perturbent la flore.
Le point sur la biodiversité
En mai 2019, la France a accueilli la 7e conférence de la plateforme mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques (IPBES), organisme scientifique dépendant de l'ONU. Le constat est accablant, une espèce animale et végétale sur huit est en voie d'extinction dans le monde. Le rythme s'accélère avec, depuis 50 ans, une vitesse 100 à 1000 fois plus élevée que celle de la disparition spontanée des organismes vivants. Depuis 1900, 20% des espèces locales ont vu leur nombre diminuer drastiquement, on compte sur le territoire français (métropole et outre-mer) 10143 espèces menacées.
Le rapport estime que 75% de la surface terrestre et 66% de l'environnement marin sont dans un état de délabrement plus ou moins important. Le milieu marin, indispensable à la survie de millions de personnes, voit 33% des récifs coralliens et plus d'un tiers des mammifères marins menacés. On ne compte plus les zones mortes dont le nombre explose surtout le long des côtes, hauts lieux de la reproduction des espèces marines. En Méditerranée, 10% des herbiers de Posidonie ont disparu au cours du XXe siècle, le rythme actuel fait craindre leur totale disparition à la fin de ce siècle ! Les amphibiens restent les espèces les plus menacées avec une diminution de leur population de 40%.
Une étude allemande basée sur l'observation et le comptage des oiseaux dans un espace protégé, ce durant 27 ans, a montré que 30% de leur population a disparu. Par ailleurs, 73 études montrent que 40% des insectes sont menacés d'extinction. En France, une étude CNRS/ Muséum d'Histoire Naturelle estime que 30% des oiseaux des champs sont en voie de disparition comme par exemple l'alouette que l'on n'entend plus chanter dans certains départements.

Ces études se penchent plus particulièrement sur la disparition d'espèces visibles. Au niveau des sols, le constat n'est guère meilleur puisque les très emblématiques vers de terre sont également menacés. Ils jouent un rôle important dans la fertilisation des sols. Ils creusent des galeries et remontent vers la surface leurs déjections sous forme de turricules riches en minéraux et humus. Leur diminution entraine donc une perte importante de fertilisants naturels qui, au lieu d'alimenter les végétaux, finissent dans les nappes phréatiques. Ces galeries facilitent la pénétration de l'eau et favorisent l'enracinement des plantes. En 1950, on comptait deux tonnes de vers de terre à l'hectare dans les champs aujourd'hui à cause de l'agriculture intensive les agronomes n'en comptent plus que 200 kg !
Toutes ces études portant sur des espèces facilement identifiables sont loin de la réalité car pour une espèce connue en voie d'extinction, combien d'autres organismes peu visibles et indispensables à l'équilibre des écosystèmes sont-ils menacés ou déjà disparu ?

Turricules : déjections des vers de terre de forme spiralée que l'on retrouve sur les pelouses, plus particulièrement en hiver
En montagne…
L'observatoire national de la biodiversité a publié une carte qui montre sans surprise qu'en montagne la biodiversité se porte mieux qu'en plaine. Mais ne nous leurrons pas, nous avons tous observé lors de nos randonnées une diminution des insectes comme les sauterelles, les grillons et les papillons qui, dans les années 80, foisonnaient dans les prairies. Le traitement sanitaire des animaux domestiques, la dispersion par le vent, non seulement des micros plastiques mais également de poussières chargées de pesticides jouent un grand rôle dans leur disparition. L'amendement des prairies a également participé à cette raréfaction.

Gazépiéride de l'aubépine - Vallon du Fournel
Sans oublier les plantes...
Selon l'étude publiée dans la revue Nature Ecology and Evolution, les plantes disparaissent deux fois plus vite que les amphibiens, les mammifères et les oiseaux réunis. En France, 15% de la flore sauvage est en voie d'extinction. Les diverses publications étudiées pour cette étude montrent qu'entre 1753 et 2018, 571 espèces de plantes ont été éradiquées, ce qui représente 0,2% des plantes connues et la tendance s'accélère. Avec un taux 2 fois plus élevé qu'avant 1900 et 500 fois plus important que le taux d'extinction naturel en 2050 nous pourrions assister à la disparition d'1/8 des espèces.

Tulipa sylvestris subsp Australis - Bonnet-Rouge
Les causes de ces effondrements en France métropolitaine
Le rapport 2019 de l'ONB (Observatoire National de la Biodiversité) fait le point sur les causes de cet effondrement dans nos territoires (métropole et outre-mer).
1. L'artificialisation du territoire
Entre 2006 et 2015, la France a perdu l'équivalent du département de Seine-et-Marne sous le béton et le macadam. L'artificialisation des sols croit 3 fois plus vite que la population avec une augmentation de +1,4% par an. A ce jour, seul 52,7% du territoire reste peu anthropisé. Les prairies permanentes ont diminué de 7,9% en dix ans seulement (de 2000 à 2010), certaines se trouvent enchâssées entre villes, cultures et sylvicultures intensives ce qui favorise la disparition des espèces inféodées aux milieux ouverts. Les habitats sont fragmentés par le développement des infrastructures de transport de toute sorte et la circulation de la faune et de la flore sauvage s'en trouve entravée. En France, seulement 20% des écosystèmes remarquables sont dans un bon état de conservation.
2. La surexploitation des ressources
Si en France métropolitaine la surexploitation est moins aigüe qu'ailleurs, c'est par omission de notre responsabilité au niveau mondial. Nous importons de nombreux produits agricoles et industriels qui sont responsables de la destruction des milieux naturels dans le monde entier (soja, huile de palme, terres rares….).
3. Le changement climatique
L'augmentation moyenne des températures mondiales est estimée à 1°C depuis 1900.
Dans notre pays depuis 1900, la température moyenne a augmenté de 1,5°C : environ 1° en plaine et 2° en montagne avec une augmentation de température atteignant 4°C observée localement près du massif du Mont-Blanc entre les années 50 et 2000. Les hivers sont plus doux avec en moyenne 2,5 jours de gel en moins depuis 1960.
L'impact sur les organismes n'est pas négligeable, ils ont de plus en plus de mal à s'adapter aux nouvelles conditions de vie. Le décalage entre le cycle des ressources alimentaires et les dates de reproduction entraîne une mortalité importante des jeunes, les oiseaux migrateurs arrivent plus tôt - 6 jours environ- sur nos côtes qu'il y a trente ans.
4. Les espèces exotiques envahissantes
Ces espèces menacent l'équilibre écologique des écosystèmes et entrent en concurrence avec les espèces autochtones. Les milieux insulaires sont les plus touchés car de nombreuses espèces y sont endémiques et ne connaissent pas la prédation. Elles n'ont donc pas développé les défenses nécessaires pour lutter contre les invasives. En 2016, 60 espèces parmi les 100 les plus envahissantes ont été identifiées en Outre-mer. En métropole, depuis 1979 on compte six espèces exotiques envahissantes de plus tous les 10 ans.
5. Les pollutions
Tous les milieux sont touchés (air, eau, sol et sédiments) par les polluants déversés dans la nature. Cette pollution touche autant la flore que la faune qui sont intoxiquées par les produits chimiques répandus par nos activités. Ces contaminants agissent sur la reproduction (perturbateurs endocriniens) et le comportement et ils induisent un manque de nourriture. L'éclairage artificiel et la circulation routière perturbent également les organismes vivants.
En France, malgré des efforts non négligeables qui ont permis la diminution des phosphates dans les cours d'eau (-37% depuis 1998), l'utilisation intensive des produits « phytosanitaires » ne cesse d'augmenter (+12% en agriculture depuis les périodes de référence : 2009-2011 et 2014-2016).
A cela s'ajoute la pollution des matières plastiques qui devient de plus en plus préoccupante puisqu'elle concerne tous les milieux et entraîne la mort directe des animaux étouffés par l'ingestion de ces résidus. Sans oublier que ces débris sont porteurs de polluants, de virus et de bactéries qui peuvent affecter la vie humaine.
En conclusion
« La disparition rapide de la biodiversité biologique est bien le résultat conjugué des activités humaines » (Rapport de l'ONB 2019).
L'ONB préconise des « changements transformateurs » qui devront être décidés par la communauté internationale lors de la conférence des parties de la convention sur la diversité biologique qui aura lieu en 2020. Cette conférence revêt un caractère déterminant.
Nous devons envisager un changement radical de nos sociétés et de nos modes de vie et de consommation individuels et collectifs afin de reconstruire la biodiversité qui pourra ainsi nous fournir de manière durable les services et ressources dont nous dépendons pour notre survie.
Il est nécessaire de renforcer et amplifier les politiques publiques en réponse aux impacts des pressions sur la biodiversité. Divers programmes existent en France comme le plan national ECOPHYTO : issu du Grenelle de l'environnement (2007) le premier plan Ecophyto avait l'ambition de diviser par deux en dix ans la consommation de phytosanitaires ; ce fut un échec quasi total, avec une consommation qui continue à progresser. Ces programmes devront être renforcés et amplifiés et c'est à chaque acteur économique de se mobiliser si nous voulons parvenir à une bonne gestion des ressources.
Au-delà de l'Etat et des acteurs publics, la société civile doit se mobiliser et un consensus sera nécessaire afin d'aboutir à une évolution favorable de notre environnement.
La survie de l'humanité est en jeu, l'effort sera important mais si nous ne désirons pas être responsables de la 6e grande extinction des espèces vivantes, il nous faut agir dès maintenant.
Ce texte a été plublié dans la Lettre du milieu montagnard n° 62 / Septembre 2019
|